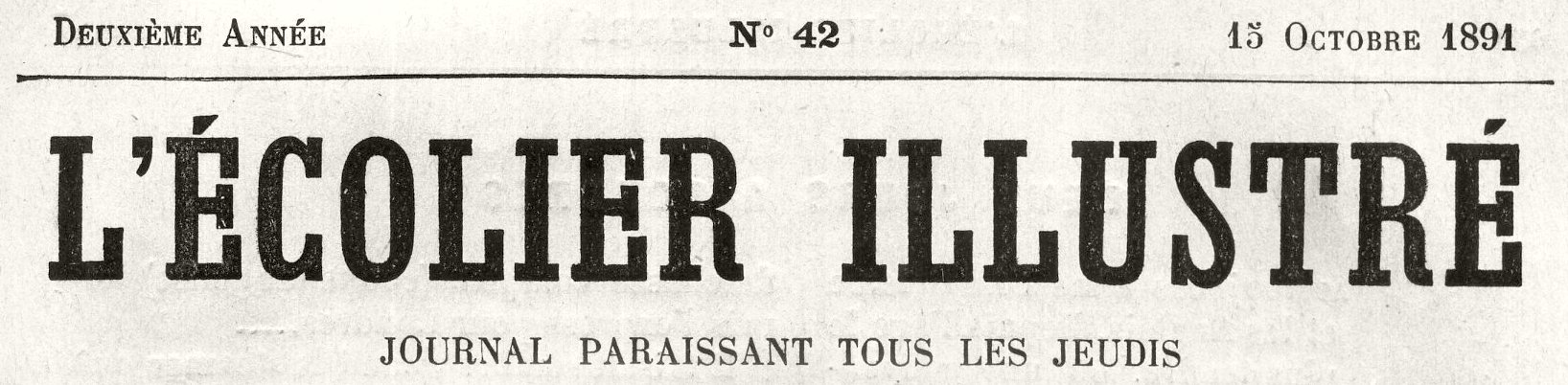Les Deux jours à Londres d’Adam de l’Isle dans la capitale anglaise à la fin du XIXe siècle
…au cours d’un voyage lunatique, quoique la Lune n’y ait aucun effet : au télescope, personne ne l’aurait même vue.
Dans L’Écolier Illustré, une revue pour la jeunesse publiée tous les jeudis par Delagrave, les nouvelles, romans à suivre, images presque de bande dessinée et articles se succèdent chaque semaine. Sans être d’une originalité époustouflante, les récits sont plaisants, bien que sages et pédagogiques, même la plus échevelée des aventures, comme le « Martin Tromp » de Raoul de Navery, ne manquera pas d’exposer quelques principes moraux bien sentis. Le jeune lecteur évitera cependant les préceptes pesants du dogme catholique, la revue demeure laïque. Il arrive même au directeur de la publication de se laisser aller à publier quelque texte taquin pour nos voisins de la « perfide Albion ». C’est le cas dans le n° 42, paru le 15 octobre 1891, dans la deuxième année d’existence de l’hebdomadaire, sous la plume d’Adam de l’Isle.
 Adam de l’Isle n’a aucun rapport avec son presque homonyme et célèbre contemporain, Villiers de L’Isle-Adam (1838 – 1889), notre homme né en 1834 est toujours vivant en 1891, malgré l’incertitude des sources de renseignements. Journaliste à ses heures, il est surtout connu pour ses traductions de l’anglais chez l’éditeur Mame à l’époque où le nom du traducteur s’imprimait sur la couverture. La langue qu’il pratique ou imitie, ainsi qu’il l’affirme lui-même, depuis l’enfance par amour de la société britannique, de ses coutumes et de ses costumes. C’est sous cette double coiffe d’homme de Lettres qu’il rédige sa première visite londonienne, après des années de théorie, franchissant intrépidement le bras mouvant qui sépare la France des côtes de l’île fantasmée et glorifiée par ce chantre des us de dandies. Une sombre rencontre parsemée de points d’exclamation répétés, teintée de persiflage et contrebalancée par une subtile dérision à l’égard de ses premières chimères culturelles. Si la visite prend un tour cocasse, le voyage à pied dans Londres s’avère toutefois une jolie excursion géographique et sociale de la capitale dans les années 1870, perçue par un français mondain peu après la dernière guerre franco-allemande.
Adam de l’Isle n’a aucun rapport avec son presque homonyme et célèbre contemporain, Villiers de L’Isle-Adam (1838 – 1889), notre homme né en 1834 est toujours vivant en 1891, malgré l’incertitude des sources de renseignements. Journaliste à ses heures, il est surtout connu pour ses traductions de l’anglais chez l’éditeur Mame à l’époque où le nom du traducteur s’imprimait sur la couverture. La langue qu’il pratique ou imitie, ainsi qu’il l’affirme lui-même, depuis l’enfance par amour de la société britannique, de ses coutumes et de ses costumes. C’est sous cette double coiffe d’homme de Lettres qu’il rédige sa première visite londonienne, après des années de théorie, franchissant intrépidement le bras mouvant qui sépare la France des côtes de l’île fantasmée et glorifiée par ce chantre des us de dandies. Une sombre rencontre parsemée de points d’exclamation répétés, teintée de persiflage et contrebalancée par une subtile dérision à l’égard de ses premières chimères culturelles. Si la visite prend un tour cocasse, le voyage à pied dans Londres s’avère toutefois une jolie excursion géographique et sociale de la capitale dans les années 1870, perçue par un français mondain peu après la dernière guerre franco-allemande.
Les deux gravures illustrant la balade sont de Fortuné Méaulle (1844 – 1901), dessinateur et graveur à la fois pour au moins l’une, et probablement l’autre signée cependant de deux initiales dont je ne connais pas la signification.
Texte intégral
DEUX JOURS À LONDRES
J’ai toujours aimé l’Angleterre et les Anglais. Depuis l’âge le plus tendre, où une gouvernante m’a révélé les secrets de cette prononciation bizarre, je me suis nourri de littérature anglaise. Personne en France, je m’en flatte, ne connaît comme moi les mœurs et coutumes de nos voisins d’outre-Manche. Je m’habille chez les tailleurs anglais les plus renommés de Paris ; Old England me fournit mes chaussettes et mes « inexpressibles »*. Enfin c’est un fait connu de tous mes amis, j’ai absolument l’air d’un Anglais. Et pourtant, j’avais atteint ma quarantième année avant d’avoir posé le pied sur le sol britannique.
Vous ai-je dit que je traduisais, imitais ou transformais des romans anglais pour les premières maisons de la capitale ? que je correspondais avec les meilleurs auteurs de la Grande-Bretagne ? Ravi de mon enthousiasme pour ses œuvres, plus d’un m’a répondu dans ce qu’il croit être la langue française :
« Pourquoi vous ne venez pas voir nous dans le Angleterre ? »
Bien des raisons m’ont retenu. Il y a d’abord la Manche ; nous autres Français, fils du beau pays où mûrit la vigne, où les moissons jaunissent, nous avons une certaine répugnance pour l’élément trompeur. Et puis, le vague même de l’invitation m’avait toujours effrayé.
Un jour, enfin ! jour mémorable, un auteur, touché profondément de l’admiration que je témoignais pour lui, sa langue et son pays, m’adressa une invitation pressante et positive, me demandant de passer quelques jours à sa maison de campagne dans le comté d’Essex.
« Le temps n’est pas des plus beaux, m’écrivait-il (nous étions au mois de novembre) ; mais c’est la vraie saison de la chasse, la vraie saison du sport. »
Le sport ! le turf ! la littérature ! voilà mes véritables passions.
Je réunis tous mes fusils, mes ustensiles de pêche ; je me commandai un costume de chasse complet (coupe anglaise) et je pris l’express pour Londres.
Il faisait sombre quand le steamer quitta Calais. L’obscurité profonde et bienfaisante jeta son voile sur la scène d’horreur qui suivit : mais j’entendis et partageai les souffrances de mes compagnons d’infortune.
On me porta dans le train de Londres. Quel tourbillon, mon Dieu ! Quelles secousses ! J’arrivai en morceaux à Charing-Cross. À peine entré dans l’hôtel, on m’offrit à manger.
« Non, répondis-je, non, mille fois non ! Il me faut du repos, un lit, le sommeil, et ne paraissez pas avant que je sonne ! »
Je dormis. Si l’on peut appeler dormir monter et descendre du plancher au plafond, puis retomber ensuite du ciel jusqu’aux abîmes. Dans les moments de calme, je m’écriais : « Si l’existence est possible en Angleterre, j’y resterai. Je me ferai naturaliser et ne me risquerai plus jamais, non jamais sur cet horrible détroit. »
Tout à coup je me réveillai, reposé, la tête encore un peu vide, mais réellement reposé. J’avais dû dormir longtemps. Il faisait toujours noir, trop noir, pour voir l’heure à ma montre, mais j’entendis la voix sonore d’une cloche voisine, l’église de Saint-Étienne, me dit-on plus tard, qui retentissait neuf fois.
J’avais dormi vingt-quatre heures !!!
* NDLR : à l’époque victorienne, la bienséance interdisait de parler de sous-vêtements que l’on nommait « the inexpressibles » : les inexprimables, justement. Le terme était à la mode en France également.

Ma foi, tant pis ! Je m’étais arrangé pour passer huit jours à Londres avant d’aller chez mon romancier. J’avais résolu de voir le lord maire, de traverser la Tamise dans le tunnel et de manger un pâté de hachis. En théorie personne, je l’ai déjà dit, ne connaissait mieux que moi les produits et le langage de la Grande-Bretagne, mais il me restait à conquérir la couleur locale. Vivre de la vie anglaise, coudoyer dans les rues ce peuple étrange que sa situation isole du reste du monde ! fréquenter toutes les classes de cette nation où les distinctions de castes se sont conservées intactes ! noble ambition ! étude sans pareille, que seul peut-être en France je puis faire avec fruit, grâce à mes travaux antérieurs, à mon éducation spéciale !
« Du haut de la colonne du duc d’York, je regarderai Londres ! Rien n’échappera à mes regards et, de retour en France, je ferai toucher du doigt à mes ignorants compatriotes les vastes résultats de mon expérience personnelle !!!… »
C’était ridicule, j’en conviens, de me lever à neuf heures du soir, mais dormir encore douze heures, était-ce possible ? J’avais faim, et en effet, par suite de circonstances indépendantes de ma volonté, j’avais l’estomac littéralement vide.
J’allumai le gaz et m’habillai. Le veilleur de nuit, dans l’immense corridor, siffla pour l’ascenseur, car ma chambre était quelque part dans les nuages, et je m’installai dans une sorte de petit wagon capitonné. Fatale erreur ! J’aurais mieux fait de descendre deux mille marches sur mes jambes ! Le mouvement de ce véhicule commode et élégant me rappela d’atroces souvenirs. Tout plutôt que de recommencer l’épreuve fatale ! Le retour par mer, dont l’ascenseur réveillait en moi les horreurs, était désormais impossible. La naturalisation s’imposait impérieusement.
En arrivant au rez-de-chaussée, je tombai dans les bras d’un porteur qui me déposa dans un fauteuil d’un air stupéfait. Aussitôt remis, je demandai la salle à manger.
On me mena dans une salle circulaire, brillamment éclairée. Un plafond lumineux, des torchères attachées aux murs répandaient partout une lumière éclatante. Une cinquantaine de tables, couvertes de nappes étincelantes de blancheur, ornées de verres de toutes formes et de toutes couleurs, étaient entourées d’une société choisie et élégante. Je n’aurais pas cru que les Anglais fussent si friands du souper.
Je demandai à haute voix dans mon meilleur anglais : du roast-beef, du porter, et un plum-pudding. Le maître d’hôtel me regarda d’un air étonné, mais me servit sans commentaires.
Tout était excellent, mais après avoir abondamment mangé, je compris qu’il serait imprudent de me coucher sans prendre un peu d’exercice.
« La table d’hôte, monsieur, dit le maître d’hôtel, est à une heure précise. »
Je compris alors son étonnement, les Anglais à cette heure avaient pris seulement « le thé » et mon repas lui avait paru trop substantiel. Mais un souper public à une heure du matin !
« Ce n’est pas étonnant, pensai-je, que l’Angleterre soit une grande nation. Comme on y mange ! Quels appétits ! quels estomacs ! Les Allemands mangent aussi énormément ; je les ai vus à l’œuvre. Mais c’était pendant l’occupation et leurs repas ne leur coûtaient rien, tandis que les Anglais sont chez eux et payent ce qu’ils consomment. »
Je descendis et me trouvai dans la cour de la gare et de l’hôtel. Il faisait très sombre ; il me sembla, au sortir du vestibule éclairé, que j’entrais dans une sorte de vapeur brune ; mais les becs de gaz étant très rapprochés, on voyait clair sur le trottoir, et je m’engageai bravement dans le Strand.
Malgré l’heure avancée, les boutiques étaient ouvertes et splendidement éclairées. Les rues étaient pleines de monde, les voitures se succédaient à la file comme en plein jour.
« Les Anglais, me disais-je, ont besoin de peu de sommeil, leurs longs repas les en dispensent. Ce n’est pas étonnant que dans le commerce et l’industrie ils soient les maîtres du monde, puisqu’ils travaillent plus que tous les autres peuples ! »
La nuit avançait, toujours le même flot de passants, les mêmes files de voitures ; tous les établissements publics ou particuliers, excepté les églises, étaient ouverts. Cette activité inouïe m’émerveilla.
« Ce n’est pas possible ! m’écriai-je tout à coup, que dans cette ville tout le monde soit en mouvement à cette heure de la nuit ! Il doit y avoir des gens qui se reposent. Les industriels, les commerçants, pour qui “le temps est de l’argent”, peuvent faire de la nuit le jour ; mais les poètes, les artistes doivent se livrer au sommeil comme dans notre pays. Si mon ami le romancier n’était pas dans son domaine du comté d’Essex, où il dort tranquillement, je l’espère, il serait certainement dans son lit à Londres. »
Tout à coup, je me souvins que j’avais sur moi une lettre d’introduction pour un peintre anglais, le fameux Yellow Green.
Avant de quitter Paris, j’étais allé voir mon ami Lecocq, le peintre de chevaux bien connu, qui tous les ans va passer quelques mois en Angleterre.
« Donne-moi une lettre pour un artiste anglais, lui dis-je, je sais que sans introduction on ne voit personne là-bas, et je veux faire sur les mœurs britanniques des études extrêmement sérieuses.
– Tu vas à Londres maintenant ? me répondit Lecocq ; tu n’y trouveras personne.
– Je sais, lui dis-je un peu sèchement (Lecocq a toujours eu la manie de croire que lui seul connaissait l’Angleterre), je sais, comme toi, que la saison est en mai et juin, mais pour des raisons personnelles je dois aller maintenant à Londres, et puisque tu dis y connaître des artistes…
– Ma foi, répondit-il, je crois que Yellow Green doit y être actuellement. Il termine sa grande toile décorative pour le Kensington Museum ; oui, je crois que tu le trouveras. »
Et s’asseyant à sa table, il m’écrivit une lettre de chaude recommandation.
Dans le désordre cérébral que m’avait causé ma traversée, j’avais oublié tout cela.
« Voici l’occasion d’étudier un curieux problème : les artistes, race charmante et flâneuse, sont-ils ici autres que dans ma belle patrie ? Ont-ils, eux aussi, l’esprit positif de cette florissante nation ? »
Me faisant indiquer par un policeman le chemin de Fulham-road, j’arrivai après bien des détours à une avenue obscure. C’était bien là. Allumant une de ces bougies dont je venais d’acheter une boîte à une horrible vieille qui m’avait poursuivi pendant un quart d’heure, je lus sur une porte le nom de mon peintre, et sonnai, non sans appréhension. Quelqu’un qui viendrait à Paris me réveiller à cette heure serait, je l’avoue, fort mal reçu.
La porte s’ouvrit pourtant. Un valet correctement vêtu et au visage grave me fit entrer dans un élégant parloir et me demanda ce que je voulais. Connaissant à fond les usages, je remis ma lettre et attendis tranquillement.
Au bout d’un instant, le même valet vint me prier de le suivre. Je montai un étage, une porte s’ouvrit et je m’avançai ; mais je m’arrêtai court, subitement aveuglé par une sorte de soleil dont les rayons m’étaient brusquement entrés dans les yeux.
« Aoh ! je suis désolé, me dit une voix sortant de ce météore enflammé, ne regardez pas le gaz. »
En effet, une douzaine de becs, décuplés par de puissants réflecteurs, frappaient sur une grande toile presque terminée, et malheureusement aussi pour moi sur les arrivants qui n’étaient pas prévenus.
Le problème était résolu ! Les peintres anglais travaillaient la nuit, et au gaz ! Peuple inexplicable, activité dévorante, même dans les œuvres d’imagination !
M. Yellow Green parlait un assez bon français, ce qui me mettait fort à l’aise ; car, je dois l’avouer, les termes techniques du langage d’atelier, que je possède admirablement en français, ayant fréquenté tous les grands artistes de ma patrie, m’étaient moins familiers dans la langue anglaise.
Je pus donc lui faire part de mon admiration, et lui dire quelques mots qui semblèrent le toucher vivement.
« Aoh ! en vérité ! mais vous êtes une nation flatteuse.
– Non, je ne flatte pas, je vous assure. » Et persuadé que les éloges sont toujours agréables à cette race charmante et susceptible, je continuai de plus belle.
Puis, poursuivi par mon idée fixe, je ne pus m’empêcher de lui exprimer mon étonnement de le voir ainsi, comme tous ses compatriotes, travailler la nuit sans relâche.
Il hésita un moment à me répondre. Mon observation même sembla lui être pénible. Je compris, car en France aussi les artistes n’aiment pas à avoir l’air de travailler. Il triompha rapidement de cette légère hésitation et reprit :
« Aoh ! la nuit, ha ! ha ! très drôle ! Vous êtes une nation très plaisante ! »
L’entrée du valet de chambre interrompit notre conversation. Il apportait, comme je m’y attendais, un plateau chargé de gâteaux secs et de verres, et une bouteille de Sherry. Après avoir exprimé à mon hôte le véritable plaisir que j’avais à boire à sa santé, je me retirai et repris ma course dans les rues.
Minuit sonnait : aucun changement, si ce n’est que la nuit devint plus épaisse et que les rues se remplirent soudain d’une nuée de gamins armés de torches. Familiarisé par la littérature anglaise avec ces apparitions, je m’empressai de profiter de leur service, et appelant un de ces enfants je lui dis de me conduire à la Tamise.
Le grand fleuve était fort pittoresque à cette heure, illuminé par les becs de gaz des quais et des ponts. Les steamers marchaient encore, plus lentement, il est vrai, et comme fatigués ; les grands chalands descendaient le courant comme en plein jour. Le parlement était éclairé et se reflétait majestueusement dans les eaux clapotantes. Les omnibus, les cabs se suivaient sans interruption ; la foule entrait et sortait à chaque station du chemin de fer métropolitain.
Malgré la longue nuit que je venais de passer dans mon lit, cette activité inouïe m’oppressait d’une fatigue inconnue. J’admirais toujours, mais cessais d’envier un peuple capable de rester debout dix-huit heures sans éprouver le besoin de s’étendre.
« Mon enfant, dis-je à mon compagnon, quand le grand cœur de Londres cesse-t-il de battre ? Quand ces foules immenses disparaissent-elles ? Quand tous ces établissements resplendissants de lumière et remplis de monde ferment-ils leurs portes ?
– Oh ! les boutiques ! dit le gamin finissant par me comprendre, elles ne ferment jamais que le samedi soir, les dimanches et les jours de fête. »
Je n’en pouvais croire mes oreilles ! Un immense étourdissement s’emparait de mon être, et je me traînai vers mon hôtel.
Il était une heure, la salle à manger était encore plus encombrée. Spectacle inoubliable ! Ces travailleurs infatigables se gorgeaient de jambons fumants, de pâtés de pigeons, de viandes froides où la graisse l’emportait sur le maigre, puis repartaient de nouveau pour des destinations inconnues !
C’étaient des natures de fer ; je renonçai à la lutte, et, prenant mon bougeoir, je montai péniblement mes dix étages, évitant soigneusement l’ascenseur.
J’étais humilié, profondément humilié et découragé ! Comment la France pourrait-elle jamais lutter, si la nécessité l’exigeait, avec ces insulaires qui défiaient les lois de la nature et savaient se passer de sommeil ?
Ces réflexions et une fatigue extrême me tinrent quelque temps éveillé sur mon lit, et je ne cessai d’entendre le bruit assourdi des roues de voiture, des machines à vapeur. Parfois des chants lointains se mêlaient à mon demi-sommeil. À plusieurs reprises, je me levai et courus à la fenêtre, regardant le ciel pour voir le jour se lever, mais la nuit durait encore ; le ciel était noir et sans étoiles, le gaz toujours allumé. Par-ci, par-là, comme une comète flambant sur le faîte d’un palais, un cône de lumière électrique indiquait la résidence d’un grand seigneur ou d’un prince.
Enfin, accablé de fatigue, je tombai dans un lourd sommeil. À mon profond désespoir, je m’aperçus au réveil que j’avais encore dormi une journée entière et qu’une nuit nouvelle recommençait pour moi.
Il était neuf heures, l’obscurité était profonde ! Quel choc terrible avait dû éprouver ma constitution pour amener un pareil changement dans mes habitudes ! Un bon tiers du temps que je destinais à mon séjour à Londres s’était écoulé, et je n’avais pas vu le jour !

Je pris la résolution de me lever pour quelques heures seulement et de donner en me recouchant l’ordre formel de m’éveiller à la première heure du matin. Il fallait absolument débuter par une vue de Londres à vol d’oiseau, du haut de la colonne du duc d’York, avant que les fumées des cheminées eussent obscurci l’horizon.
Jusqu’alors je n’avais pas eu à me plaindre du service. Mais je commençais pourtant à prendre en grippe le maître d’hôtel de l’établissement. Il n’y avait pas à en douter, cet homme dissimulait sous sa serviette d’office un rire étouffé quand il me regardait. J’avais commandé des tartines de fromage et un pâté de hachis. Ce sont là, comme chacun sait, des plats éminemment anglais : tous les romans en font foi ! J’ai toujours considéré comme un devoir de manger dans mes voyages la nourriture nationale et de boire la boisson du pays.
« D’où vient cette hilarité intempestive ? demandai-je sévèrement en voyant que cet homme ricanait en me servant. Est-il donc singulier à Londres de demander du fromage et du hachis pour son souper ?
– Pour souper ? Non, monsieur, sans doute, mais pour déjeuner, ce n’est pas l’usage.
– Pour déjeuner, répétai-je. Que voulez-vous dire ? C’est, j’en conviens, singulier qu’un peuple, qui mange jour et nuit, donne ce nom-là à un de ses repas, car en fait vous ne jeûnez jamais. Mais appeler déjeuner un souper, voilà ce que je considère comme le comble de l’absurde !
– Pourtant, monsieur, nous appelons ce repas : le déjeuner. Mais il est possible qu’un étranger comme monsieur qui va se coucher après son goûter et qui a de si étranges habitudes donne à ce repas un autre nom !
– Voyons ! mon brave homme, repris-je, ne nous fâchons pas. Je suis un peu souffrant et la tête me tourne en vous écoutant. »
Le maître d’hôtel murmura quelques mots sous sa serviette, et je crus entendre :
« Ce n’est pas étonnant, quand on mange des pâtés de hachis et qu’on boit du porter à son déjeuner. »
Oui, j’étais sûr cette fois qu’il avait bien dit « déjeuner ».
« Voyons, mon brave, voyons, vous dites que j’ai des habitudes étranges ! Soyons raisonnables. Vous êtes plus étrange encore. Voilà la seconde nuit que je passe dans votre capitale, personne ne s’y couche, et tous mangent, boivent, et vont à leurs affaires comme en plein jour !
– Mais nous sommes en plein jour monsieur ! répondit le maître d’hôtel d’un visage sérieux, il est maintenant neuf heures et demie du matin !..
– Neuf heures du matin ! m’écriai-je en montrant la salle éclairée au gaz, les rues remplies de lumière, et au-dessus des maisons le ciel sombre et noir. Grand Dieu ! vous appelez cela le plein jour !
– Certainement, monsieur, et la journée n’est pas vilaine pour une journée de novembre.
– Et le soleil ? Qu’est-il devenu ?
– Je ne sais pas, monsieur. Probablement il est allé au bord de la mer avec l’aristocratie ; nous n’avons jamais de soleil à cette époque. »
J’étais renversé, écrasé !
« Partons, partons ! » m’écriai-je.
Mais mon invitation, mon ami du comté d’Essex ! Je demandai un dictionnaire que je feuilletai d’une main fiévreuse.
« Essex, c’était bien cela, pays bas et marécageux, brouillards épais et fréquents ! »
Impossible d’y songer ! Si la métropole, avec ses millions de becs de gaz, sa lumière électrique, toutes les merveilles de la science et de la civilisation, ne pouvait triompher de cette terrible obscurité, ne m’offrait qu’une nuit noire, sans soleil, sans lune, sans étoiles, que serait « ce comté bas et marécageux » ?
C’est la saison de la chasse ! me disait mon romancier, mais ce pays ne pouvait donner la vie à aucun oiseau de jour. M’invitait-on à chasser le hibou et la chauve-souris ?
Je songeai vaguement à la vieille réputation de la perfide Albion,
« Serait-ce un piège ? » m’écriai-je, non, plus de visite ! plus de courses dans Londres ! En France ! en France ! par le plus court chemin ! Bravons les souffrances que je prévois et qui seront cruelles, mais sortons avant tout de ce cauchemar ! »
Le jour même, à travers les rues éclairées au gaz, je gagnai la station noire et obscure et je pris mon billet pour la France.
Le brouillard se déchirait sur les côtes de ma patrie, les étoiles brillaient dans le ciel,
« Demain, me dis-je, demain, je reverrai le soleil ! »
Adam de l’Isle.
NDLR : On notera le dégoût continental pour la traversée maritime de la Manche qui n’a rien à envier à celui d’Hercule Poirot le siècle suivant, sous la plume d’Agatha Christie !